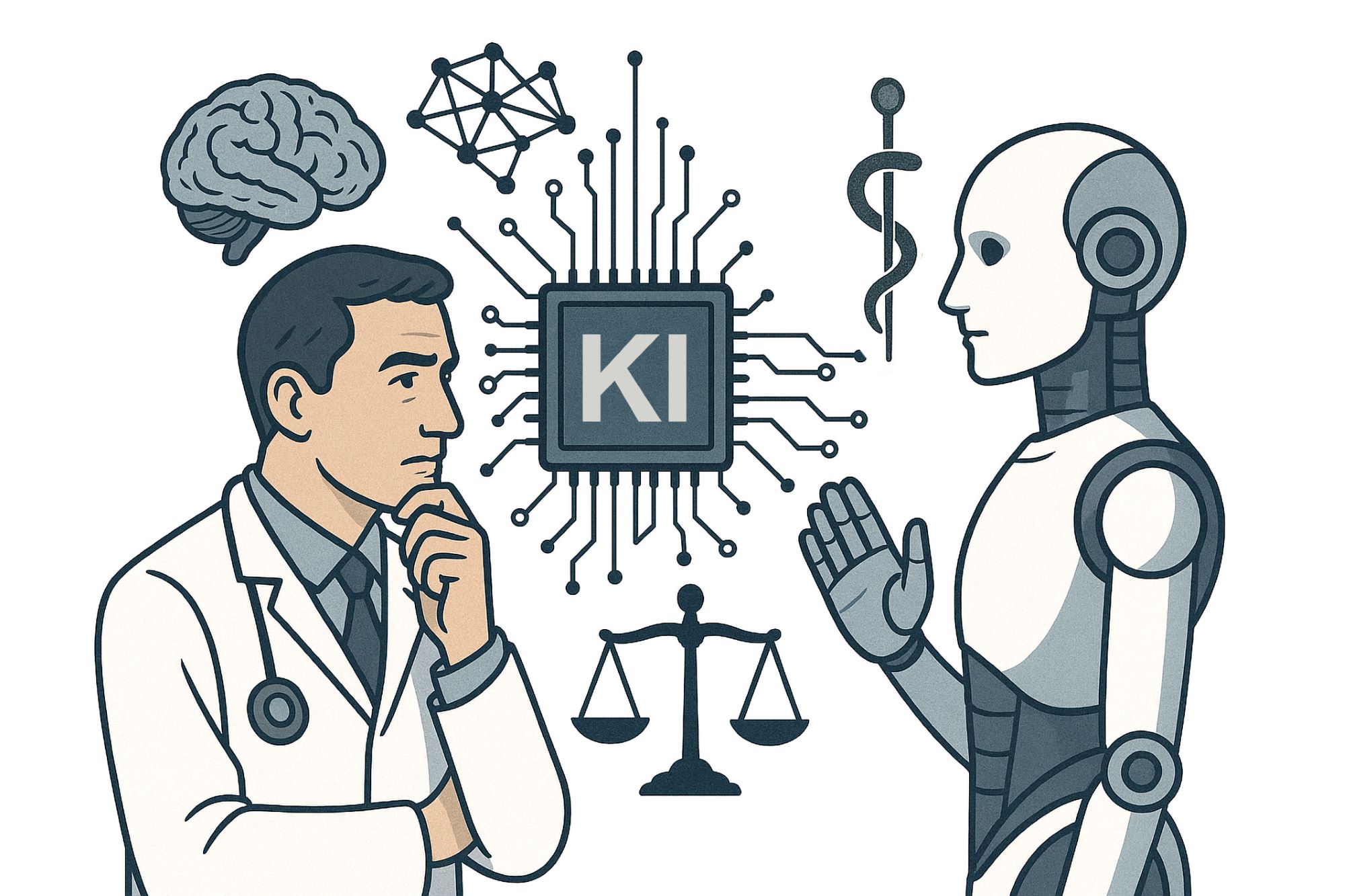Progrès et enjeux médico-éthiques

En tant qu’héritage culturel, la médecine n’est pas juste un domaine scientifique, elle fait aussi partie intégrante de la vie et des valeurs individuelles et sociales des êtres humains. Elle est donc sujette à une constante évolution. En ce sens, les progrès médicaux représentent indéniablement une grande utilité pour les personnes malades. Ce que l’on voit moins, c’est que cette évolution met à l’épreuve l’identité professionnelle de toutes les personnes qui y oeuvrent. Ainsi, la découverte des effets antibiotiques de la pénicilline a eu des répercussions sur le rôle des médecins. Aujourd’hui, avec l’omniprésence et la prolifération de l’intelligence artificielle dans la médecine du 21e siècle, nous sommes face à une série de défis, notamment de nature éthique [1, 2, 3, 4].
La relation thérapeutique : un pilier de la médecine
La médecine est une science de l’action : l’interface entre les connaissances scientifiques et leur application clinique s’avère dès lors d’une importance primordiale. Mais la pratique médicale va bien au-delà des aspects techniques. Elle présuppose le développement d’un dialogue interpersonnel : la relation thérapeutique. On touche là au coeur même de la médecine. En effet, seule une relation thérapeutique sérieuse permet de mettre en pratique les postulats – désormais largement admis – que sont le respect de l’autonomie des patients et la décision partagée. Aujourd’hui, l’accent se déplace progressivement de la notion de « shared decision making » à celle de « collaborative » ou « deliberative decision making ». Cela peut paraître une simple nuance. En réalité, c’est le coeur du sujet.
Intelligence artificielle et relation thérapeutique
L’intelligence artificielle comme outil de l’action médicale apporte son appui dans les domaines de la prévention, du diagnostic, de la thérapie et de la recherche. Et c’est une bonne chose. Mais on ne peut faire l’impasse sur l’ambivalence inhérente à chaque outil médical. S’il est mal compris, pas assez contextualisé et ne fait pas l’objet d’une réflexion éthique digne de ce nom, le risque est de voir son effet sensiblement réduit, voire annihilé. L’Apprenti sorcier de Goethe en est sans doute l’exemple le plus parlant.
Plus concrètement, si on permet à l’intelligence artificielle de gagner en influence sur l’action médicale sans contrôle approprié, on accorde à l’algorithme un capital-confiance pour le moins discutable. Il en va de même si l’intelligence artificielle est élevée au rang de partenaire à part entière, métamorphosant ainsi le dialogue thérapeutique en un (pseudo-)trialogue. Cela aurait forcément un impact sur le point de vue des patients, mais aussi sur celui des médecins. Bien sûr, toute transmission d’informations médicales comporte des risques intrinsèques, que ce soit lors d’un cours, dans un manuel ou à travers l’intelligence artificielle. Il s’agira donc de rester vigilant par rapport à ces dangers, faute de quoi nous pourrions surestimer la fiabilité de l’information et, a contrario, sous-estimer des éventuels biais cognitifs. Cette vigilance est primordiale dans le cas des algorithmes de l’intelligence artificielle en raison de leur omniprésence et de leur disponibilité immédiate.
Lorsque des phénomènes de nature subjective perdent la place et l’attention qui leur revient uniquement parce que l’intelligence artificielle ne parvient pas à les représenter ou ne les trouve pas, il est impossible de tirer pleinement profit du potentiel qu’offre une relation thérapeutique solide. Même lorsque l’intelligence artificielle fournit des renseignements a priori parfaitement clairs, ceux-ci doivent encore trouver leur chemin dans la vraie vie, au sein de la situation thérapeutique. Et dans cet instant concret, le vécu subjectif joue un rôle important. Prenons un exemple : l’intelligence artificielle est en mesure de calculer bien plus vite qu’un être humain si le nombre et la combinaison des symptômes observés suffisent pour poser un diagnostic d’épisode dépressif sévère selon la CIM-10. En revanche, elle n’a pas accès au ressenti que peut avoir la personne souffrante : l’IA ne sait pas ce que c’est que de n’avoir plus le goût de vivre, de lutter contre des pensées suicidaires, de ne plus être capable de s’ouvrir à la personne en face. Alors que le personnel médical, lui, en est capable.
En termes plus abstraits : dans la relation médecin-patient, si le recours à l’intelligence artificielle fait que l’équilibre entre dialogue interpersonnel et information purement technique penche en faveur de la seconde (même de façon imperceptible), des renseignements importants pour la thérapie se perdent. Ce risque ne concerne pas que la psychiatrie mais la médecine dans sa globalité, bien qu’à des degrés divers. D’ailleurs, la Chambre médicale allemande a mis récemment en garde contre une forme de « paternalisme technologique » susceptible de mettre à mal les standards actuels de l’éthique médicale [5].
Affaiblir le principe de dialogue au sein de la relation thérapeutique peut en outre porter préjudice à la confiance mutuelle. Nombre de médecins se voient aujourd’hui confrontés par leurs patients à des informations générées par l’intelligence artificielle. Sur le fond, il n’y a rien à redire, sauf si cela instille un climat de contrôle et de méfiance dans les échanges autour du traitement. Il serait vain de s’entêter dans des rôles traditionnels et dépassés : la seule solution réside dans le dialogue ouvert. Mais dialoguer exige du temps, et celui-ci est une denrée rare en médecine.
Éthique et intelligence artificielle
En éthique médicale, la réflexion ne mène pas à des lois, mais aboutit à des postulats étayés visant à promouvoir des comportements responsables dans le domaine de la médecine. Les valeurs, les objectifs et les risques doivent être pondérés en permanence. Et comme pour les lois, il demeure une marge de manoeuvre lors de l’application du cadre à une situation concrète. Comment gérer cette marge de manoeuvre tout en gardant une approche centrée sur la personne : voilà une des tâches les plus difficiles qui incombent à toutes les professions de la santé. En revanche, certaines valeurs font consensus et n’ont pas besoin d’être réévaluées à chaque cas, notamment le respect de la décision autonome d’une personne capable de discernement.
Les implications éthiques de l’intelligence artificielle font l’objet de vifs débats [6]. Nous en abordons trois dans ce qui suit.
La notion de « personne »
Du point de vue épistémologique, la notion de « personne » a toujours fait et fait encore l’objet de controverses. En médecine, l’approche doit rester pragmatique et reconnaître à la personne sa dignité inaliénable ainsi que la capacité d’établir des relations, d’assumer des responsabilités, de prendre des décisions et d’agir en conséquence. Les maladies peuvent certes entraîner des limitations, mais en aucun cas abolir le statut de personne.
Un algorithme d’intelligence artificielle qui répond à des questions n’est pas une personne : c’est un programme conçu par des personnes pour traiter des données. On peut tenir des débats philosophiques sur la pertinence ou non de faire une distinction stricte entre « personne » et « non-personne ». Mais ces discussions n’apportent rien aux médecins censés accompagner les patients dans des décisions délicates et lourdes de conséquences.
Responsabilité
L’autonomie va de pair avec la responsabilité qu’une personne assume. Ce principe vaut tant pour les patients que pour les personnels de santé. La manière de traiter des informations médicales importantes fait partie de cette responsabilité, en particulier en ce qui concerne les conséquences diagnostiques et thérapeutiques.
Un algorithme d’intelligence artificielle ne peut endosser de responsabilité. Celle-ci reste entre les mains des personnes qui agissent : les patients sont responsables de ce qu’elles ou ils choisissent de communiquer (ou non) lors de la consultation, et les médecins ont la charge d’élaborer le processus diagnostique et thérapeutique. Le fait de procéder avec l’aide de l’intelligence artificielle ne joue ici aucun rôle.
Intimité et confidentialité
Il s’agit là de deux notions proches l’une de l’autre, mais pas identiques. Le terme d’intimité (« privacy ») évoque l’existence d’un vécu subjectif auquel je suis la seule personne à avoir accès. Je peux toutefois décider de m’en ouvrir à quelqu’un d’autre, par exemple à mon médecin. La confidentialité désigne la garantie que les données sensibles et personnelles sont protégées et qu’elles ne peuvent être transmises sans l’autorisation de la personne concernée [7]. Il va de soi que ces deux notions constituent des éléments incontournables d’une pratique responsable de la médecine.
Mais l’intelligence artificielle soulève la question éthique de la transparence dans la collecte de données, leur traitement et leur transmission [8] : est-ce que les personnes concernées connaissent la source et la fiabilité des informations à partir desquelles un algorithme génère ses réponses ? Les patients sont-ils au courant de ce qu’il advient de leurs données personnelles lorsque celles-ci sont introduites dans un algorithme pour affiner un diagnostic ? Et quel est le rôle des données saisies par des personnes non malades à l’aide de capteurs équipés d’intelligence artificielle (« wearables »), données qui sont également sauvegardées et analysées par ces mêmes outils ? La croissance exponentielle du recours à l’intelligence artificielle dans la médecine et ailleurs donne à ces questions un caractère toujours plus urgent et complexe.
Ce qu’il faudrait faire
L’intelligence artificielle permet de créer ou d’améliorer les options médicales. Mais ce sont les personnels de santé qui ont la responsabilité d’identifier ces options et de les mettre en oeuvre au bénéfice des patients. Une approche critique et lucide est indispensable afin de bien peser les pour et les contre de l’intelligence artificielle au regard des fondamentaux de l’éthique professionnelle.
Pour se servir de l’intelligence artificielle de manière responsable et éthique, le corps médical, comme toutes les autres professions de la santé, ne pourra pas se contenter d’acquérir continuellement de nouveaux algorithmes. Les outils de l’intelligence artificielle devront constamment faire l’objet d’une réflexion, tant sur le plan de la pratique clinique que de l’éthique. Et il faudra s’assurer que le fruit de cette réflexion fasse partie du développement de ces outils ainsi que de la recherche sur l’intelligence artificielle.
Enfin, comme l’intelligence artificielle devrait continuer à gagner du terrain dans la médecine, les aspects médico- éthiques de cette évolution devront s’insérer de manière concrète et durable dans les cursus de formation de tous les métiers de la santé ainsi que dans la formation postgraduée.
Résumé
La médecine est une science de l’action qui place les patients au centre du dialogue avec des professionnels compétents. Comme par le passé, elle a aussi besoin de moyens auxiliaires. Un algorithme capable d’apprendre et d’interagir bilatéralement avec des êtres humains – en d’autres mots l’intelligence artificielle – représente aujourd’hui un outil polyvalent et très impressionnant sur le plan technique. Mais il soulève des enjeux considérables en termes d’éthique médicale.
Potentiellement, l’intelligence artificielle permettra de réaliser des progrès considérables tant dans la pratique médicale que dans la recherche. Mais elle ne modifiera pas le coeur même de la médecine, à savoir la relation interpersonnelle basée sur le dialogue.
Littérature
- Ahmed M, et al. A Systematic Review of the Barriers to the Implementation of Artificial Intelligence in Healthcare. Cureus 2023 15(10): e46454. DOI 10.7759/cureus.46454
- Bouderhem R. Shaping the future of AI in healthcare through ethics and governance. Humanities and Social Sciences Communications (2024). 11: 416. https://doi.org/10.1057/s41599-024-02894-w
- Lambert S I. An integrative review on the acceptance of artificial intelligence among healthcare professionals in hospitals. npj Digital Medicine (2023). 6: 111. https://doi.org/10.1038/s41746-023-00852-5
- Waller R, Moghraby O S, Lovell M (2023). Digital Mental Health: From Theory to Practice. Cambridge University Press.
- Bundesärztekammer. Künstliche Intelligenz in der Medizin – Stellungnahme der Bundesärztekammer auf Empfehlung ihres wissenschaftlichen Beirats. Deutscher Ärzteverlag, Köln, 2025.
- Tang L, Li J, Fantus S. Medical artificial intelligence ethics: A systematic review of empirical studies. Digital Health (2023). 9: 1-22. DOI: 10.1177/20552076231186064
- Maatz A, Schneller L, Hoff P. Privacy and Confidentiality in Psychotherapy: Conceptual Background and Ethical Considerations in the Light of Clinical Challenges. In: Trachsel M, Gaab J, Biller-Andorno N, Tekin S, Sadler J Z (eds) The Oxford Handbook of Psychotherapy Ethics. Oxford University Press, Oxford (2020): 340-351. DOI: 10.1093/oxfordhb/0780198817338.013.27
- Pasquale F. The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information. Harvard University Press (2015).